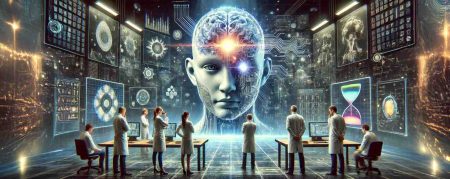Gouvernance
La fusion des SI, une idée moderne dans la banque et ailleurs ?
Par François Jeanne, publié le 20 mars 2025
Le DG de Société Générale a plaidé pour une réunion des forces IT des grands acteurs bancaires français. Surprenant ? Plutôt logique quand on se rappelle les fusions de SI qui se sont succédé depuis 40 ans dans le secteur. Et pourquoi ne pas étendre l’idée à d’autres ?
Même pour qui a connu l’époque où les caisses départementales, puis régionales, des banques à ancrage territorial n’en finissaient plus de fusionner leur SI, la nouvelle a eu l’effet d’une petite bombe.
Lors du 160e anniversaire de Société Générale, son directeur général Slawomir Krupa a en effet évoqué sur le podcast interne, 2050 Investors, l’idée d’une mutualisation des SI des principales banques françaises.
Utopie ? Son argumentaire se tient en tout cas. Il explique que les dépenses technologiques des principales banques avoisinent les 25 Md€ tous les ans (4,7 rien que pour la Société Générale), et suggère que la création d’une structure qui se chargerait de réaliser ce même travail pour tous ces grands acteurs, pourrait faire baisser ce coût annuel d’un montant allant jusqu’à 10 Md€.
L’opportunité de l’IA, un exemple des bienfaits du groupe ?
La Société Générale est bien placée pour savoir que les fusions et/ou les migrations de SI, comme celle finalisée en 2023 avec le groupe Crédit du Nord, ont des coûts importants. Et si elles ont pu apparaître soutenables par le passé, au nom de la rationalisation des dépenses, elles deviennent questionnables à une époque où la mise en œuvre des derniers progrès technologiques ne peut supporter le moindre retard, sous peine de se voir dépassé par la concurrence.
Slawomir Krupa
Directeur général de Société Générale
« Les dépenses technologiques cumulées des principales banques avoisinent les 25 Md€ tous les ans. La création d’une structure qui se chargerait à elle-seule de réaliser ce même travail pour tous ces grands acteurs, pourrait faire baisser ce coût annuel d’un montant allant jusqu’à 10 Md€. »
Il cite dans son podcast l’exemple de l’IA, susceptible de bouleverser les équilibres actuels sur le marché bancaire : dans les banques, « un grand nombre de processus industriels ne sont pas optimisés. On a tous des systèmes plus ou moins avancés dont l’architecture date d’une quarantaine d’années. (…) On a beaucoup de discontinuités, de processus manuels à effectuer. De ce point de vue, l’IA est une énorme opportunité. »
Une opportunité qu’il serait dommageable de voir un acteur s’en emparer seul, ou du moins très en avance sur les autres, avec un potentiel d’économies de fonctionnement pour l’heureux élu qu’il estime à potentiellement jusque 20 %.
Un argument de plus en faveur de la mutualisation ? Il y en a sans doute d’autres… et dans d’autres domaines. Par exemple, la lecture des rapports de la Dinum, sur les retards des grands projets ministériels, ou celui, récent, de la Cour des Comptes sur leurs résultats très décevants en termes de gain de productivité, en particulier par rapport aux attendus, a de quoi suggérer une approche radicalement différente de l’informatique de l’État : pourquoi en effet ne pas définir un SI cible, avec l’obligation pour tous les ministères d’organiser une convergence ?
La recherche d’un meilleur ratio coûts/ services publics rendus, mérite peut-être mieux qu’une moue dédaigneuse.
Une plateforme commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne
Créée officiellement en 2009, la BPCE aura mis 15 ans à lancer un projet de construction d’une plateforme IT commune, deux ans après le regroupement de toutes les entités en charge du développement pour les différents réseaux au sein de BPCE Solutions informatiques.
Le groupe en attend une modernisation technologique, « optimisant le service offert à 35 millions de clients » et enrichissant « le quotidien des collaborateurs du groupe », selon sa communication officielle.
Cela passera par la consolidation des nouveaux projets sur une seule plateforme, dérivée de celle des Caisses d’Epargne (MySys).
Les économies attendues seront de 45 % sur les nouveaux projets à mener après la migration. Celle-ci devrait durer deux ans et demi au total et coûter 750 M€.
À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :
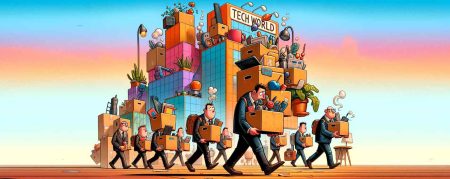
À LIRE AUSSI :