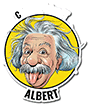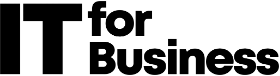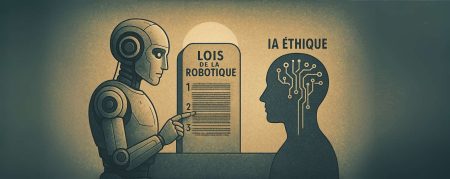Gouvernance
Patrick Bertrand (Cegid) : “La transformation numérique est du ressort du top management”
Par Stéphane Demazure, publié le 15 mai 2014
Patrick Bertrand
Directeur général de Cegid et vice-président
du comité Transformation numérique du Medef
Cofondateur de l’Afdel (Association française des éditeurs de logiciels) qu’il préside jusqu’en 2012, puis président du CNN (Conseil national du numérique), Patrick Bertrand axe désormais son engagement sur la transformation numérique des entreprises françaises au sein du Medef.
Quelle est la mission du comité Transformation numérique du Medef ?
Patrick Bertrand : À la différence du Conseil national du numérique, dont les membres sont désormais nommés par décret en Conseil des ministres, le Medef est une instance de représentation des entreprises en France. Alors que le CNN a vocation à être consulté par le gouvernement sur de nombreux sujets liés au numérique, le Medef, lui, s’intéresse à la logique entreprise et au tissu économique. Sous la présidence de Pierre Louette, comme moi ancien membre du CNN – et par ailleurs directeur exécutif d’Orange –, l’ancien comité Numérique a été rebaptisé comité Transformation numérique car il semblait important de mettre l’emphase sur la dynamique de transformation du tissu économique global sous l’impulsion du numérique. Nous n’avons pas vocation, par exemple, à pousser le seul secteur du numérique – c’est l’objet d’autres institutions –, mais de promouvoir la transformation numérique auprès de toutes les entreprises.
Avez-vous trouvé la recette magique pour pousser les entreprises à revoir leur stratégie sous l’angle du numérique ?
PB : La richesse du Medef est de pouvoir travailler avec d’autres comités, comme le comité Santé ou le comité Dépenses publiques, pour faire avancer les choses. Mais qui trop embrasse mal étreint, et l’option développée par Pierre Gattaz, président du Medef depuis juillet 2013, est de faire en sorte que chaque comité intègre indépendamment le numérique dans sa sphère d’influence. La vision est de sortir de la logique des rapports de 50 à 100 pages. Il y en a eu de très bons, mais il faut aller plus vite. Nous comptons plus sur la mise en évidence de business cases, dans différents secteurs, pour créer un facteur d’identification et d’imitation de la part de l’ensemble du tissu économique.
Avez-vous détecté de nombreux exemples de transformation réussis ?
PB : Il y en a quelques-uns. On peut citer notamment Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique. Toujours dans ce domaine, figure Legrand. Quand vous entendez Gilles Schnepp, son PDG, parler de l’activité de son entreprise, vous ne reconnaissez pas le Legrand que nous avons tous connu et qui fournissait des prises électriques. Bien sûr il en vend toujours, mais celles-ci sont désormais « intelligentes », connectées. Elles mesurent l’énergie consommée et peuvent être actionnées à distance, de manière logicielle. Legrand s’est engagé dans la domotique et aussi en tant que fournisseur de configurations globales qui sont déployées par ses revendeurs.
On rencontre aussi des exemples de transformation numérique dans le domaine du retail, là où les acteurs doivent désormais parler « omnichannel » ou « multicanal » : l’interaction avec le client peut très bien commencer sur le Web, en magasin, se continuer sur un autre canal, et aboutir à une commande grâce au mobile et une livraison à domicile, mais pourquoi pas aussi en boutique. Faire en sorte que tous ces circuits, ces systèmes, se parlent est une nécessité si l’on veut être sûr de capter le client. Et derrière, il y a aussi des processus qui doivent changer. Il y a des enjeux dans de nombreux domaines. Dans le secteur automobile par exemple, de plus en plus de réparations ont trait à des réglages informatiques. On pourrait imaginer qu’il ne soit plus nécessaire de se déplacer au garage pour les réaliser.
Qu’est-ce qui empêche les entreprises d’aller plus vite vers un « modèle numérique » ?
PB : Le frein le plus important est le phénomène d’appropriation culturelle. C’est un enjeu stratégique et global, et pas une question de moyens, ni d’être le meilleur en logistique, en relation client, en fabrication, sur la qualité des produits, etc. Nous devons faire comprendre aux comités de direction des PME et des grands groupes que l’enjeu se situe à leur niveau. Lorsqu’une entreprise est dans un état d’avancement faible de sa transformation numérique, c’est très clairement que le top management n’a pas pris conscience du fait qu’il s’agissait d’un enjeu stratégique.
L’informatique, pour reprendre ce terme « ancien » que sous-tend le numérique, ce n’est plus seulement un moyen, comme cela a pu l’être au même titre qu’une usine pour une entreprise manufacturière ou un parc automobile pour une entreprise dont l’une des activités est de livrer. C’est quelque chose qui va transformer l’approche globale de l’entreprise dans ses produits, ses relations avec ses clients, ainsi que dans son fonctionnement interne. Il n’y a qu’à voir ce que permettent les outils de travail collaboratif. Aujourd’hui, des ingénieurs répartis sur différents sites peuvent travailler sur le même projet simultanément. C’est un formidable accélérateur. De la même façon que la possibilité d’intervenir à distance sur un même dossier a complètement bouleversé la relation entre l’entreprise et son expert-comptable.
Quel est alors le rôle du DSI dans cette mutation ?
PB : Tous les observateurs s’accordent à dire que la transformation numérique ne peut émerger que d’une approche top-down. Le top management doit donc s’approprier le fait que la digitalisation de l’entreprise doit faire partie de son socle stratégique dans les années qui viennent. Naturellement, le DSI fait partie de ce dispositif, il en est un moteur. Les DSI ont compris que leur métier n’était pas mort, loin s’en faut, et qu’il prenait de la valeur : leur job n’est plus tellement de s’occuper de la gestion d’un réseau et d’un équipement informatique interne à l’entreprise, mais plutôt de fournir une réponse adaptée aux usages. Par exemple, permettre aux collaborateurs d’utiliser les données de l’entreprise en situation de mobilité. Pour cela, il doit avoir fait un vrai travail d’architecte. C’està- dire avoir rendu homogène grâce à des interfaces interapplicatives (API), un système d’information qui est par ailleurs hétérogène du fait de la multitude des besoins des utilisateurs. C’est la mise en place de ces API qui permettra de conserver l’homogénéité de l’ensemble, alors même que l’évolution des métiers des collaborateurs (DRH, directeur de la production, etc.) conduira à un sourcing de plus en plus hétérogène pour répondre à des besoins fonctionnels changeant plus fréquemment.
D’architecte du système d’information, peut-il passer au rang d’architecte de la transformation ?
PB : Le DSI est déjà devenu DI ou directeur de l’information. Et quand on dit information, on pense bien sûr Big Data. C’est son rôle de proposer à son entreprise des actions pour mieux utiliser la richesse incroyable dont elle dispose au travers des informations sur ses clients, sur ses prospects et sur les usages. Il a clairement un rôle éminent à jouer dans la transformation en tant que CDO (dans sa signification de Chief Data Officer), c’est-à-dire de patron de l’information, de garant des technologies, de l’intégrité des données, des outils à utiliser pour capter et trier les données. Pour prétendre au rang de CDO (au sens Chief Digital Officer), il doit avoir une vision plus large, plus métier. Il doit savoir analyser les usages et voir comment les optimiser grâce à la digitalisation. Ce sont plutôt deux axes complémentaires. Néanmoins, son rôle est nécessairement très important du fait que, dans une « entreprise numérique », l’information est clé.
Et comment peut-il créer un terrain propice à l’émergence d’une stratégie numérique ?
PB : L’innovation, ça ne se décrète pas. Il faut créer un contexte de foisonnement qui va faciliter les initiatives et, à un moment donné, générer l’innovation. Il y a un terme souvent utilisé dans ce domaine : la « sérendipité ». On cherche dans une voie et finalement, à force de brasser les idées, de développer, on découvre une innovation, non prévue, dans un autre domaine. Il y a un autre terme que j’aime bien et que l’on retrouve dans l’ouvrage The Lean Start-up, c’est la nécessité de savoir pivoter. Pivoter, c’est ce qu’on doit faire, par exemple, lorsqu’on n’arrive pas à vendre un produit que l’on pense bon. C’est peutêtre simplement parce qu’il y a erreur sur la cible, ce dont on se rend compte en explorant plus précisément les données de vente, de retour, etc. Une fois la bonne cible déterminée, il reste à reconfigurer le produit et son marketing.
Dans ce contexte, l’objectif du DSI est notamment de permettre à chacun, par les outils qu’il met en place, de brasser les informations pour que puisse émerger l’innovation, le prochain produit, le prochain service.
Pouvoir pivoter nécessite d’être agile. La taille d’une entreprise ne constitue-t-elle pas un frein à son innovation ?
PB : Non, il n’y a pas d’incompatibilité entre la taille et l’innovation. D’autant qu’il faut pouvoir la financer, cette innovation. Donc il faut une certaine taille. En revanche, il est vrai que si l’organisation de l’entreprise est plutôt sur un modèle très hiérarchique, cela aura plus de mal à fonctionner. L’une des logiques à adopter est alors de découper son organisation en petites équipes dédiées – proches de leurs clients et donc à leur écoute –, et en même temps agiles et aptes à collaborer. L’innovation vient bien souvent de l’écoute du client. Au top management ensuite de prioriser les demandes et les projets en fonction de la stratégie. On en revient toujours à la capacité du top management à opter pour la bonne stratégie.
En temps qu’observateur du tissu économique français, êtes-vous satisfait de la maturité des entreprises en matière de stratégie numérique ?
PB : Non, nous sommes en retard ; en particulier dans les PME, même si certaines se sont transformées avec succès. Mais je considère que prendre conscience de son retard est une opportunité. Ça bouge en France depuis deux ou trois ans, et cela va s’accélérer. Toutefois, il faut encore travailler. Il faut de l’huile de coude de conviction, de l’huile de coude d’investissement et de financement, de l’huile de coude au niveau des collaborateurs et du management, et de l’huile de coude de formation. À l’école, mais aussi et surtout dans la formation professionnelle, pour insuffler le numérique là où les habitudes installées rendent sa pénétration plus difficile, et ceci indépendamment de l’âge ou des générations. C’est un super challenge !
Propos recueillis par Pierre Landry